La politique culturelle, enjeu des élections municipales genevoises
Faire encore mieux, pas moins
Dans deux semaines, un nouveau Conseil municipal
de la Ville de Genève aura été élu. Or dans
la République fort centralisée de Genève, où les communes ont
moins de compétences que partout ailleurs, il est un domaine qui
échappe au primat cantonal : la politique culturelle, dont la
Ville de Genève se trouve être, pour des raisons historiques
autant que financières et démographiques, l'acteur principal.
Certes, une évolution s'est dessinée ces dernières années, et
l'adoption massive par le peuple d'une initiative pour que le
canton prenne, enfin, ses responsabilités culturelles permet
d'espérer que la Ville ne détermine plus presque seule le champ,
les sujets, les objets et les domaines de la politique
culturelle genevoise -mais il faudra du temps pour que ce
changement presse forme, et même lorsque cela aura été acquis,
la Ville restera l'acteur institutionnel principal de l'offre
culturelle, et le Conseil municipal le lieu où les moyens de la
politique culturelle seront définis. Le tissu associatif
culturel genevois le sait bien, qui ce soir va engager un
dialogue direct avec des candidats au Conseil municipal des
différents partis politiques. Ce débat se tiendra à 20h à
l’Alhambra. Des
dix principales villes suisses, Genève est celle qui investit
le plus dans la culture. Ce n'est pas dire qu'elle y investit
trop, c'est dire qu'elle ne doit pas relâcher son effort.
Qu'il lui faut faire encore mieux, pas en faire moins.
Résister au vent mauvais de l'épuration culturelle
Résumé à gros traits, le poids du budget de la culture sur le budget de la Ville de Genève est passé en une génération de 25 à 20 % (chaque pourcent pèse près de quinze millions, quand même), et le poids du Grand Théâtre sur le budget de la culture a été réduit dans les mêmes proportions. A quoi tient cette double réduction ? au renforcement de l'action sociale de la commune et au renforcement de son engagement dans le domaine sportif, ce qui réduit mécaniquement le poids du budget culturel dans le budget général, et à l'élargissement du champ des acteurs culturels subventionnés, ce qui réduit tout aussi mécaniquement le poids du Grand Théâtre dans le budget culturel. Cet élargissement du nombre d'acteurs culturels subventionnés, c'est cela, précisément, la "politique de l'arrosoir" -et c'est à cela que nous tenons. Le choix entre cet "arrosage" que la droite feint de détester (tout en le pratiquant quand elle le peut) et la "priorisation", c'est le choix entre accorder des moyens au plus grand nombre d'acteurs possibles, ou les concentrer sur quelques-uns. Mais sur lesquels ? il y a très gros à parier que les heureux gagnants seront ceux qui déjà bénéficient du plus fort soutien : le Grand Théâtre, l'OSR, la Nouvelle Comédie. Et qu'est-ce qui se passerait si le Conseil municipal de la Ville ne votait pas le budget et la subvention du Grand Théâtre ? Qui peut croire que le canton s'y substituerait ? Même lui n'y croit pas...
Sur quoi fonder une "politique culturelle de
gauche" ? Certainement pas sur l'imposition par la collectivité
publique subventionnante de contenus et de formes de création et
d'expression mais d'abord sur le refus de la distinction entre
une culture patrimoniale et une culture d'expérimentation : la
représentation d'une oeuvre du patrimoine, c'est de la culture
vivante autant que la création d'une oeuvre nouvelle. Quant Gli
Angeli interprètent devant un public une cantate de Bach, ce
sont des musiciens vivants qui l'interprètent devant un public
vivant... et c'est donc de la musique vivante.
Partons de l'hypothèse optimiste d'un renforcement
significatif du soutien cantonal aux grandes institutions
culturelles : pour la Ville, cela permettrait, en réduisant le
poids financier du soutien qu'elle leur apporte, de renforcer le
soutien à la culture de création et de réduire l'écart entre le
soutien dont elle bénéfice et celui dont bénéficient les grandes
institutions patrimoniales. Mais cette réduction de l'écart doit
passer par le renforcement du soutien aux acteurs de la culture
de création, pas par un affaiblissement du soutien à ceux de la
culture patrimoniale. S'agissant des grandes institutions, le
soutien de la Ville doit donc pouvoir être réévalué en tenant
compte de l'engagement des autres collectivités publiques
genevoises (le canton et les communes). Quant
aux secteurs peu ou pas dotés, il s'agit évidemment de renforcer
le soutien dont ils bénéficient le cas échéant, et de leur
accorder un soutien quand ils n'en bénéficient pas. Et cela vaut
pour la culture nocturne comme pour la culture diurne. Enfin,
nous sommes, à gauche, évidemment favorable à une réévaluation
des financements accordés aux acteurs culturels non
institutionnels ne serait-ce que pour leur permettre de
rémunérer les artistes au moins au niveau du minimum revendiqué
par les organismes qui les représentent. Et non seulement nous n'envisageons pas une réduction des
ressources allouées au tissu associatif culturel, mais nous
entendons bien augmenter ces ressources.
Un rapport établi sur mandat de la Ville de Genève
a fait l'état des lieux des "statuts, rémunérations et
prévoyance des artistes à Genève". Le rapport, rendu public
l'année dernière, constatait l'instabilité et de la précarité des métiers de la
culture et de la faiblesse des rémunérations qui lui sont
associées, avec une médiane de 3300 francs mensuels tous
revenus confondus, soit la moitié du salaire mensuel brut
médian en Suisse. Le rapport conclut à la nécessité
d'agir en urgence "à tous les niveaux pour garantir une vie
décente aux travailleurs et travailleuses de la culture
genevoise", en liant précisément statut, rémunération et
prévoyance, et en les améliorant sans risquer de réduire l'offre
culturelle. L'étude identifie trois leviers d'action : le
respect des barèmes de rémunération et des grilles tarifaires
existant, et la prise en compte, dans ces barèmes et ces
grilles, de toute la chaîne de production, d'abord. Le statut,
ensuite : deux modèles existent, qui ont chacun leurs avantages
et leurs inconvénients : le salariat (l'AMR l'a généralisé pour
les artistes qui s'y produisent) et l'indépendance; les
collectivités publiques pourraient soutenir le "portage
salarial", qui, un peu à la manière des entreprises de travail
temporaire, joue formellement le rôle d'employeur. Elles
pourraient aussi accompagner le passage au statut d'indépendant.
Enfin, le rapport préconise une redéfinition du statut
professionnel des artistes en ce qui concerne la prévoyance
professionnelle : celle des artistes (quand ils en ont une)
souffre (comme d'ailleurs leurs rentes AVS-AI) des contrats
courts, des intermittences, des interruptions de carrière. Cela,
évidemment, est hors du champ de compétence d'une commune -si ce
ne l'est pas hors des moyens dont dispose une ville comme
Genève. Mais ce qui n'est pas hors du champ de compétence de
cette commune, c'est d'affirmer sa volonté de poursuivre une
politique culturelle accordant à tous les champs culturels,
toutes les disciplines, toutes les formes, et au plus grand
nombre possible d'acteurs culturels, les moyens de créer,
d'expérimenter, de représenter.
C'est cela, une politique culturelle d'"arrosage".
Cet "arrosage", c'est le le soutien au plus grand nombre
possible d'acteurs culturels, c'est le refus du repli sur
quelques uns, qui seraient de toute évidence ceux qui déjà
bénéficient du plus fort soutien. L'"arrosage", c'est la
condition du pluralisme culturel -du pluralisme des lieux, des
acteurs, des formes, des discours, des disciplines... Cela
suppose des moyens, financiers et humains. Cela suppose aussi
une volonté d'assurer aux artistes les moyens de travailler, et
de vivre de leur travail. Cela suppose enfin une volonté plus
politique encore : celle de résister au vent mauvais de
l'épuration culturelle qui souffle depuis quelque temps et s'est
renforcé depuis que l'inculture est venue, ou revenue, au
pouvoir ailleurs que chez nous. Aux Etats-Unis, par exemple,
mais dont rien ne nous préserve ici.
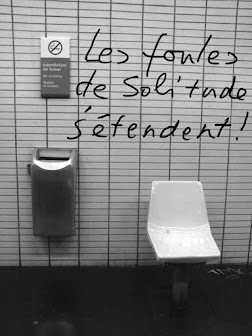


Commentaires
Enregistrer un commentaire