Quand la droite saucissonne l'abolition d'un impôt
Une tranche à 200-250 millions
Depuis des années, des lustres, des décennies, même, la majorité de droite du parlement fédéral veut abolir un impôt qui ne frappe que les entreprises : le "droit de timbre" sur les émissions et les négociations d'actions. Et sachant que l'abolition pure et simple de cet impôt ne passerait pas le cap du vote populaire, même si elle passait celui du vote parlementaire, elle a malignement décidé de saucissonner cette abolition, d'abolir cet impôt tranche par tranche, et a fait voter l'abolition de la première. Coût pour les caisses fédérales : 200 à 250 millions pour la première tranche du saucisson, deux milliards et 750 millions pour le saucisson entier, au moment où la Confédération, les cantons et les villes auraient besoin de plusieurs milliards pour financer une sortie de la crise sociale provoquée par la coronapandémie. Un référendum était indispensable contre ce premier acte de l'abolition du droit de timbre, il a été lancé par la gauche, il a abouti, on votera le 13 février prochain.
Une redistribution à l'envers, du
bas vers le haut...
L'abolition progressive du droit de timbre, c'est
une redistribution, mais du bas vers le haut, au profit de ceux
qui n'en ont pas besoin : ceux qui accumulent les gains en
capitaux (qui ont progressé de 18 % en moins de deux ans, et ne
sont pas en tant que tels soumis à l'impôt en Suisse. Le droit
de timbre, ce sont en grande partie les banques, les assurances,
les holdings qui le paient. Échappant à la TVA qui frappe tous
les autres secteurs, ces entreprises contribuent par cet impôt
spécifique à un effort dont on ne voit pas pourquoi elles
seraient libérées. Car ce sont évidemment elles qui
bénéficieraient de son abolition. Comment la Confédération
procéderait-elle pour éponger cette perte immédiate d'au moins
200 millions, et cette perte à terme de près de trois milliards
? Comme d'habitude, en reportant des charges sur les cantons,
qui les reporteront sur les communes (et d'abord sur les
villes)... qui ne pourront les reporter nulle part, sinon sur
les contribuables, les habitants, le tissu associatif, les
usagers des services publics (transports, crèches, institutions
culturelles), la fonction publique.
Cet enjeu, finalement, renvoie à un enjeu plus
fondamental : celui de la fiscalité, comme élément central d'un
contrat social acceptable par tous. Quand le monde des
contribuables se divise entre ceux, les ordinaires, qui ne
peuvent échapper à l'impôt et ceux, les plus riches et les plus
puissants, qui y échappent en se soustrayant aux contraintes
légales, il ne faut pas s'étonner des révoltes fiscales : pour
ceux d'"en bas", l'impôt n'est plus perçu que comme un moyen
supplémentaire d'enrichir ceux "d'en haut", et quand les
politiques d'austérité, ou l'obsession des équilibres
budgétaires, se traduisent par des réductions ou des
suppressions de prestations, le discours sur l'impôt comme
source de financement des services publics n'apparaît plus que
comme une escroquerie. "La fiscalité est
centrale dans le pacte républicain", rappelle le sociologue
Alexis Spire. Mais cette centralité a une condition : pour que
les citoyennes et les citoyens consentent à l'impôt, il faut
qu'eux-mêmes en aient décidé, et qu'il soit juste. Et
justement utilisé : l'impôt doit financer les tâches des
collectivités publiques et réduire les inégalités, pas finir
dans les poches des "décideurs" politiques ou de leurs
marionnettistes privés.
Mais si l'impôt
est un levier de redistribution des ressources des riches
vers les pauvres, pourquoi est-il désormais davantage
contesté par les pauvres (et les "classes moyennes") que par
les riches, alors que l'instauration de l'impôt sur le
revenu -qui est exemplairement un impôt redistributif- avait
été violemment contesté par les plus riches, les professions
libérales et les indépendants (dont les paysans) ? Même
l'impôt indirect (la TVA), injuste et non redistributif
n'est que peu contesté par ceux qu'il frappe pourtant le
plus lourdement (les moins riches, précisément) alors que
les taxes spécifiques sont dénoncées pour cette raison même,
leur injustice, quand (comme les écotaxes, ou les taxes sur
les carburants), on ne remet pas en cause la légitimité de
leur assiette, mais le fait que, non proportionnelles, elles
pèsent plus lourd sur les personnes, les ménages, les
entreprises, qui ne peuvent se passer de consommer ce
qu'elles taxent (l'essence ou le diesel, par exemple, pour
les ménages des périphéries sans transports publics
efficaces).
La question de la fiscalité contient, forcément, celle de la redistribution. "L'injustice fiscale est le processus par lequel, alors que les inégalités augmentent, le système fiscal devient de moins en moins distributif" résume l'économiste Gabriel Zucman. La fiscalité, en effet, n'est pas un instrument d'extraction de ressources financières, mais un système de redistribution des ressources existantes, et d'affectation de ressources à des investissements qui concrétisent des choix politiques. En période de crise sociale, elle permet d'investir dans la lutte contre la pauvreté. En période de crise environnementale, elle devrait permettre d'investir dans la création d'une économie respectueuse de l'environnement -voire restauratrice des environnements détruits. En période de crises sociale et environnementale conjuguées, elle doit financer le renforcement des secteurs publics essentiels (l'éducation, la santé, l'énergie). Socialement, ceux qui gagnent le plus doivent contribuer le plus. Environnementale, ceux qui polluent le plus doivent contribuer le plus. Le droit de timbre que la droite veut abolir peut y contribuer -son abolition, évidemment pas.
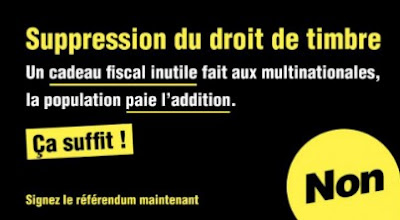

Commentaires
Enregistrer un commentaire